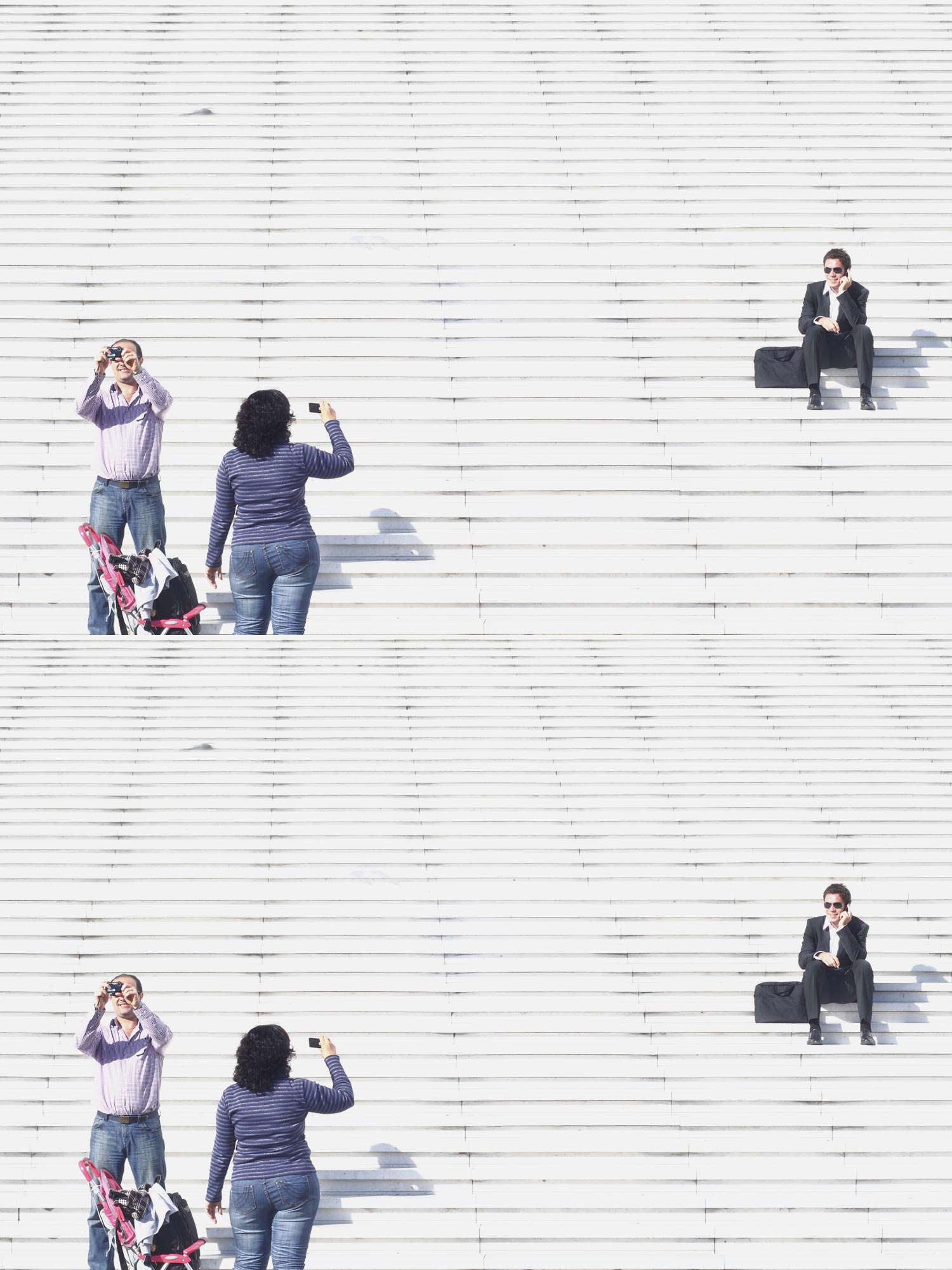Penser la circonstance consiste aussi sans doute à remettre en question notre rapport à notre territoire. En interrogeant la notion de « paysage » dans différentes cultures non occidentales, cet article fait apparaître la possibilité d'une « cosmophanie » où la mentalisation du territoire est associée à des valeurs sociales. Une piste de lecture qui pourrait permettre de comprendre d'une autre façon l'art contextuel, et l'oeuvre de Mazen Kerbaj en particulier.
L'invention du paysage
Toutes les cultures, les civilisations n'ont pas pensé l'environnement dans lequel elles vivaient par le prisme du paysage. Le « Paysage » est une notion très occidentale dont les amorces de la pensée commencent à la Renaissance. En 1573, sous l'orthographe de « paisage » elle désigne l'« étendue de pays que l’œil peut embrasser dans son ensemble »(GARNIER, Hippolyte, 1224 ds HUG.). Le suffixe « age » va substantiver un morceau de pays, morceau découpé par une posture verticale et un regard. Ce décrochage, ce découpage que l'homme occidental fait à son environnement, et qu'il trouve le besoin de nommé à cette époque, correspond au bouleversement épistémologique et ontologique qu'il vit, dont le mouvement a été initié il y a bien longtemps par les penseurs de l'antiquité. Par exemple, le déploiement des sciences dont la Renaissance est un moment particulièrement fécond doit beaucoup à Platon, initiateur de ce que Heidegger appellera le « chôrismos » : l'écart entre le monde sensible et le monde intelligible.
Et le « paysage » est une notion directement impliquée par le chôrismos, c'est-à-dire, que dans l'acte même de sa reconnaissance, il met l'environnement à distance. Le « paysage » est d'une certaine manière anti-circonstanciel, car tout ce qui fait la singularité de sa circonstance se retrouve enlevé, arraché de force de telle sorte que le paysage reconnu est touché d'une certaine immuabilité. Il suffit de regarder un stand de cartes postales pour constater que le paysage est un morceau d'énoncé, auquel correspondent des règles précises de lisibilité, qui font de l'appréhension sensible de l'environnement une image à déchiffrer.
De surcroît, la notion de « paysage », telle qu'elle a été pensée par l'occident, explique notre rapport très « capitalistique » – c'est-à-dire notre quête de plus-values et de profits – à notre territoire. Celui-ci en effet se lit en terme de panorama, de point de vue et de géographie, qui en liste les ressources minérales et végétales. L'environnement est envisagé en fonction de sa capacité à faire telle ou telle culture, à pouvoir donner tel ou tel minerai, à proposer telle ou telle forme de tourisme (plage ou montagne)…
Cosmophanie
Mais, comme nous l'enseigne l'anthropologie, l'homme a d'autres façons de négocier avec son territoire.
Souvenons-nous du chant des pistes et de la relation particulière qu'entretiennent les aborigènes australiens avec leur environnement. Bruce Chatwin (Le chant des pistes, 1987) nous raconte dans son récit de voyage que l'ensemble du territoire australien est chanté. La totalité de l'environnement des aborigènes est cartographiée par le chant. Les montagnes, les arbres, les cours d'eau sont d'abord les traces vivantes de héros fantastiques qui ont fait exister le monde en le chantant. Car au commencement du monde aborigène, il n'y avait qu'une plaine obscure que les dieux mythiques, lorsqu'ils se sont réveillés, ont transformée et nommée en chantant. Puis, lorsqu'ils se sont levés, ils ont parcouru le territoire en continuant de chanter, interprétant des chemins de chant qui dans le même moment créaient le monde. Lors de leur traversée mythique, chacun des dieux, qui sont les ancêtres des aborigènes australiens, a laissé dans son sillage des notes et des bribes de mots qui font du territoire australien un réseau de piste chantée. Le « paysage » australien porte alors les traces de cette création, et ces traces sont comme la partition du « temps du rêve ». Les chants des pistes, si vous les connaissez, sont à la fois une carte du territoire australien et un topo-guide.
« En théorie, du moins, la totalité de l'Australie pouvait être lue comme une partition musicale. Il n'y avait pratiquement pas un rocher, pas une rivière dans le pays qui ne pouvait être ou n'avait pas été chantée. On devrait peut-être se représenter les songlines sous la forme d'un plat de spaghetti composé de plusieurs Iliade et de plusieurs Odyssée, entremêlées en tous sens, dans lequel chaque “épisode” pouvait recevoir une interprétation d'ordre géologique. » (Bruce Chatwin, 1987, op. cit.) Et les traces laissées par les dieux lorsqu’ils ont créé le monde, leur urine et leur sang transformés en source et en rivière, leur organe abandonné changé en roche et en montagne, leur passage qui laisse des traces de couleurs dans les pierres, les trous, les failles qui sont les signes de leur saut ou de leur chute, ne sont pas seulement une évocation de l'histoire mythologique passée, ils sont encore et toujours quelques choses de vivant. Chaque trace est le signe vivant d'un rêve auquel les aborigènes sont associés en tant qu'individus et en tant que clans. Les dieux ont donné à leurs descendants le chant du territoire que les hommes doivent continuer à chanter. Marcher dans les pas de ses ancêtres sans changer un mot ni une note, c’est assurer le maintien de la Création. Le paysage, la cosmophanie aborigène, est intimement lié à l'ordre social des peuples qui l'habitent. Il n'y a pas de distance entre l'homme et son environnement immédiat comme dans notre civilisation occidentale. Au contraire, des enjeux sociaux se déploient dans le territoire lui-même.
Et les aborigènes australiens ne constituent pas le seul exemple a projeter des valeurs sociales dans le territoire. Chez les Indiens Navajo, par exemple, on trouve une lecture mythologique du paysage qui induit une conduite sociale. Comme dans beaucoup de cultures extra européenne le concept d'« art » comme le concept de « beau » sont intraduisibles et n'ont pas d'équivalent dans le langage. Chez les Indiens Navajo, le mot qui s'en rapprocherait le plus et qui pourrait se traduire par « beauté », mais auquel il faudrait immédiatement ajouter « santé » et « harmonie », c'est hozho. Mais hozho ne désigne pas un état (qui nous fait dire de telle ou telle chose qu'elle est belle) mais bien un processus, un mouvement. En rentrant dans la réserve navajo (les frontières de la nation Navajo touchent la nation Ute au point de concours de quatre États : Arizona, Utah, Colorado, Nouveau-Mexique en s'étendant à travers le plateau du Colorado) un panneau de circulation vous conseille de « conduire en beauté » (drive in beauty). Ce panneau en dit long sur le sens d'hozho : c'est une attitude, une façon de se conduire « en harmonie », en « bonne santé » avec le reste du monde, donc en « beauté ». La maladie chez les Indiens Navajo est le résultat d'une mauvaise conduite laquelle ne correspond pas à une attitude hozho. Dans la cosmogonie Navajo, l'état d'équilibre santé-harmonie-beauté hozho a été confié aux Navajos par leurs dieux. Ils doivent conserver l'état d'équilibre du monde qui leur a été confié par leurs attitudes et leurs actions. Ils perpétuent le mouvement de santé-beauté-harmonie initiée par les dieux et qui fait du monde ce qu'il est. De ce fait, l'environnement n'est pas une entité hors du groupe des Indiens Navajo, mais bien un tout cohérent habité du même mouvement à laquelle l'homme participe. Une fois encore, le territoire n'est pas mis à distance, mais bien incorporé et vecteur de valeur sociale. L'attitude d'équilibre à tenir avec la nature est aussi une attitude d'harmonie a tenir avec l'ensemble de la communauté.
Starry Night
On m'excusera ce retour abrupt à la pièce de Mazen Kerbaj, Starry Night. Mais il semblerait que cette pièce, les conditions extrêmes avec lesquelles elle a été réalisée et enregistrée, remette en question toutes les frontières théoriques qui nous permettaient jusqu’alors de penser l'oeuvre et l'acte de faire œuvre. Starry Night est tout entière accrochée à la circonstance de sa réalisation dont l'enregistrement ne peut être qu'une empreinte, et tout discours théorique sur cette performance ne peut que tendre vers les limites du commentaire esthétique lui-même.
Difficile de se mettre à la place de Mazen Kerbaj lorsqu'il décida la nuit du 14 juillet au 15 août de jouer du saxophone à son balcon en improvisant sur le tir des bombes de l'armée israélienne qui tombaient sur Beyrouth. Nous pouvons considérer cette improvisation à la fois comme un élan vital, un pied-de-nez à la mort, mais aussi comme la volonté de témoigner de cet élan et de témoigner de ce moment vibrant, sonore, particulièrement éprouvant.
De ce geste, comme la musique qui en résulte, j'en perçois pour ma part une tentative désespérée de réenchanter le monde, exacerbée par la circonstance particulière, mais exemplaire pour certaines pratiques artistiques contextuelles. L'explication politique, qu'on pourrait ironiquement nommée la part intelligible du moment vécu, est balayée dans du sensible pur où les vrombissements des avions, les explosions et le souffle vital de l'artiste sont réunis dans une même vibration. Cette part intelligible n'en paraît d'ailleurs pas moins absurde et irraisonnée, elle se brise sur la réalité sonore circonstancielle où la violence de l'acte et la beauté du geste musical sont sans commune mesure avec les explications et les discours justifiant les bombardements. Mazen Kerbaj, dans l'action de Starry Night, reconnecte l'environnement sonore, social et politique aux perceptions à vif de son propre corps et à celui de l'auditeur permettant à lui-même et aux autres d'incorporer la circonstance et d'en faire l'ultime question du vivre ensemble. Il réenchante le monde.
Rosa E. Erosaria est chercheur à l'IFREMER (Institut Français Régional pour l'Exploration de la Musique et sa Recherche).