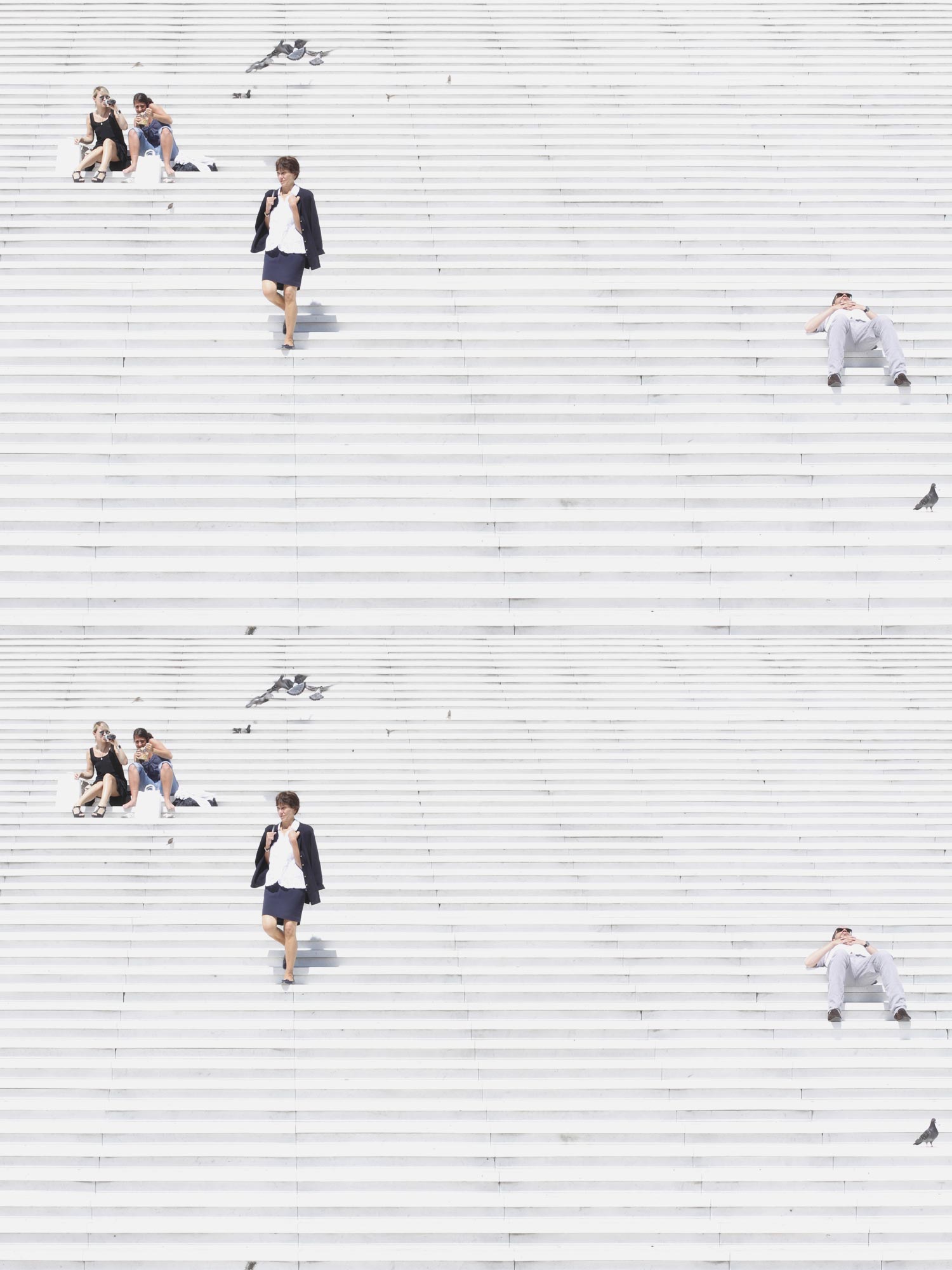et le lapin sonore


Il ne faudrait pas que les circonstances de la création ne servent de prétextes à des créations de circonstance… Quelques arguments contre une mode opportuniste.
Origine d’un concept
Si l’on prend la circonstance à sa racine, c’est-à-dire si on ramène ce substantif à son étymologie, elle est signifiée par le latin circumstantia, de circum (autour) et stare (être debout). La circonstance serait ce qui est, ou se tient, autour… Mais autour de quoi ou, pour aborder cette question moins frontalement, qu’est-ce qui différentie le sujet principal d’une proposition circonstancielle de son entour, si ce n’est, en dernier recours, par le régime de préposition qui l’organise syntaxiquement ? Car en rhétorique, la circonstance n’est pas seulement de temps ou de lieu, mais peut aussi se rapporter à la personne ou à la chose, aux moyens, aux motifs ou aux manières d’être. Autrement dit, quand on formule une proposition circonstancielle, on peut tout aussi bien énoncer une condition extérieure au sujet principal de l’énonciation qu’une condition intérieure, plusieurs conditions du même genre ou plusieurs conditions des deux genres. D’ailleurs, on emploie très souvent le terme « circonstance » au pluriel, comme désignant chacun des faits particuliers et secondaires associés à un événement principal, ou à une situation, et où se mêlent des conditions exogènes et endogènes aux faits principaux. Cela est particulièrement vrai dans son usage juridique où « l’événementIl faut rappeler qu’en droit français on est censé juger l’acte et non pas la personne qui l’a commis… Du moins en principe, car la tendance actuelle est à l’inversion de cette disposition, notamment dans le cas où la personne n’a pas le « bon profil », par ses antécédents en matière de délits ou de crimes, ou par des caractères identitaires propres à provoquer le rejet, ou encore dans le cas de crimes considérés comme particulièrement odieux : par exemple l’agression d’un enfant qui est presque toujours cataloguée comme une « circonstance aggravante » et amène à porter le jugement principalement sur la personne qui n’a pas craint de transgresser cet « interdit ». Aussi, à la suite de tels événements et afin de rester conforme au droit en son principe, le législateur est-il tenté d’adapter la loi en aggravant les peines encourues, voire en faisant en sorte que la personne mise en cause ne puisse jamais « s’acquitter de sa dette envers la société », qu’elle soit suivie, marquée à vie comme les voleurs et les prostituées au Moyen-Âge. On voit par là que la circonstance peut perdre le caractère contingent de « ce qui se tient autour » pour être instituée en quasi moteur de l’événement, pour acquérir une sorte « d’essentialité », et ce, jusqu’à devenir elle-même l’objet du jugement, après bien sûr qu’elle ait été, elle-même, expertisée, donc normalisée, donc, paradoxalement, dévitalisée, réduite à l’état de « faux marbre » parce que laborieusement reconstituée à partir des débris d’une chose déjà morte. » est jugé aggravé ou atténué par un ensemble de faits qui tiennent autant à des contingences extérieures – au mauvais endroit, au mauvais moment – qu’à l’histoire du « mis en cause » – par exemple une enfance maltraitée qui sera prise en compte comme une donnée interne à l’individu pour éviter la remontée aux origines, à une « faute originelle » qui serait une circonstance non plus simplement externe mais totalement séparée et, comme telle, impossible à juger.
La circonstance ne pourrait donc être définie comme « ce qui se tient autour » que par une stricte ségrégation sémantique qui ferait fi de ce « centre » autour duquel elle gravite. De plus, dans « la » circonstance, se croisent quasi nécessairement ce qui provient de l’entourage de celui qui la désigne comme telle et ce qu’il projette sur ces « faits contingents », projection qui les qualifie en raison d’une « intentionnalité » qui se fonde dans une autre temporalité que la leur et, en cela, leur confère aussi une certaine « épaisseur de temps » qui les arrache à la temporalité du simple accident tout en les reliant à celle de « l’événement principal » dans sa perception. Pour ainsi dire, la temporalité des circonstances internes à l’observateur et à son expression (le « je » unique qui perçoit et dit qu’il perçoit) affecte la temporalité du fait principal (complément du verbe qui l’établit) et des circonstances extérieures (complément circonstanciel) en les incorporant, en les élargissant à toutes ses dimensions : intellectuelles, sensorielles et charnelles, à son « corps propre » pour reprendre les termes de Maurice Merleau-Ponty. Il n’y aurait, finalement, de pure rationalité dans le concept de circonstance que dans le cas où l’observateur pouvait énoncer une proposition en se posant lui-même comme pure extériorité, ce qui serait l’hypothèse de « l’image scientifique » du monde. Tous les autres cas relèvent tendanciellement d’une approche phénoménologique qui ne prétend rendre compte que de « l’image manifeste » du monde, dans laquelle tout fait et toute circonstance incorporent un peu de la substance du sujet qui perçoit, tout comme il assimile la matière alentour.
Hypothèse phénoménologique et hypothèse scientifique
L’hypothèse phénoménologique propose une saisie représentative de la réalité à partir du seul critère du corps propre de l’observateur, au moyen d’une certaine utilisation des organes des sens, avec une intentionnalité qui le relie à la réalité, et par la saisie des significations qui sont vécues, à la fois, comme inhérentes au sensible et comme déployées par lui-même. Et si les divers sens ne sont que des modes de structuration différents d’un même organisme et son comportement une manière systématique de mettre en forme l’entourage, alors on peut bien dire que le corps n’est pas dans l’espace, mais habite l’espace, qu’il n’est pas dans le monde mais va vers le monde ; qu’une circonstance perçue est une circonstance « signifiée » et, par conséquent, qu’elle est le résultat d’un dépliage du « feuilleté » dans lequel elle coexiste avec les autres faits extérieurs au sujet qui perçoit et d’un repliement de ce fait particulier avec ceux qui existent en lui. Dans cette expérience du corps qui ne passe pas par des représentations, qui ne se subordonne à aucune fonction symbolique ou « objectivante », la circonstance ne nous situerait dans de monde qu’en tant que nous projetterions autour de nous notre propre situation, donc un « savoir » qui, en retour, nous situerait sous tous rapports.
L’hypothèse scientifique a, quant à elle, son point de départ dans un principe de séparabilité des causes et, plus radicalement encore, si ces causes pouvaient être décrites en termes de composantes élémentaires et donc ramenées à une unique essence causale, dans un principe de superposition qui permettrait de décrire complètement la situation observée. Cette démarche qui suppose, de toute façon, le minimum d’implication de l’observateur, exclut tout rapprochement de la circonstance avec la conjoncture qui fait pourtant percevoir à l’esprit un ensemble de faits qui coïncident par hasard comme ayant un sens et concoure ainsi à la production d’une signification dont la prédiction est mathématiquement impossible, qui est en tout cas sans aucune nécessité. L’hypothèse scientifique, cependant, est toujours voisine du scientisme qui prétend résoudre les problèmes philosophiques par une connaissance adéquate des choses. Son idéal serait la carte, et son écriture, qui représenteraient comme des parties juxtaposées les faits comme autant de « lieux » de surfaces diverses reliés entre eux par des canaux de plus ou moins grande taille. Mais, en même temps qu’il défie la démarche scientifique, le scientisme et son hyperrationalité, littéralement sa « paranoïa », indique la voie d’une « idiotie du réel », d’une phénoménologie légère et joyeuse, débarrassée de son appareillage théorique, comme cela est démontré par l’exemple de la « Carte de l’Empire » de George Luis Borges ou celui de la « Topographie anécdotée du hasard » de Daniel Spoerri.
Cartographie
George Luis Borges, dans son Histoire universelle de l’infamie / Histoire de l’éternité [1951], propose un texte intitulé « De la rigueur de la science » : « En cet empire, l’Art de la Cartographie fut poussé à une telle perfection que la Carte d’une seule Province occupait toute une ville et la Carte de l’Empire toute une Province. Avec le temps, ces Cartes Démesurées cessèrent de donner satisfaction et les Collèges de Cartographes levèrent une Carte de l’Empire, qui avait le Format de l’Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. Moins passionnées pour l’Étude de la Cartographie, les Générations Suivantes réfléchirent que cette Carte Dilatée était inutile et, non sans impiété, elles l’abandonnèrent à l’Inclémence du Soleil et des Hivers. Dans les Déserts de l’Ouest, subsistent des Ruines très abîmées de la Carte. Des animaux et des Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n’y a plus d’autre trace des Disciplines Géographiques. » C’est un texte qu’il prétend avoir trouvé dans un livre publié au XVIIe siècle à Lérida, en Catalogne, et qu’il attribue à un auteur fictif, Suarez Miranda. Umberto Eco s’appropriera cette « esthétique de l’apocryphe » dans un pastiche où il expose « scientifiquement » les difficultés de la réalisation de la « Carte de l’Empire ». Le propos n’est pas ici de discuter de cette mise en abîme de faux et de trompe-l’œil, mais de constater qu’elle répond « en profondeur » de la mise à plat en quoi consiste la cartographie et, incidemment, toute distribution mathématique des faits.
On trouve dans le texte de George Luis Borges une écriture fictive de l’espace, un double imaginaire qui lui restitue un peu de la profondeur et de l’humanité perdues dans « l’art de la cartographie », quand bien même ce ne serait que sous la forme incertaine des animaux et des mendiants qui en habitent les ruines. La leçon pourrait être étendue aux faits dont les choses qui sont dans l’espace sont les supports ou les médiations. Dans un espace cartographié, les faits seraient juxtaposés comme des choses, et seule la fiction serait capable de « démesure » : elle seule pourrait les resituer dans une perspective humaine, c’est-à-dire dans un complexe de relations non algébriques. Il faut préciser que la démesure ici convoquée n’est pas celle qui est dénoncée par Jean Clair dans son ouvrage : Hubris – La fabrique du monstre dans l’art moderne [2012]. Il n’y a en effet rien de monstrueux dans le fait de ne pas respecter la norme euclidienne de la mesure, ou alors c’est tout l’homme qui serait, dès son origine, monstrueux.
Justement, dans l’approche phénoménologique, la fiction a le même statut que les réalités tangibles : déjà, la profondeur et la grandeur des choses y sont les attributs de leur seule situation, proche ou lointaine, sans repère, et sont liées à une dimension d’enveloppement plutôt qu’à une dimension de juxtaposition. Et puisque ces qualités viennent aux choses de ce qu’elles se situent par rapport à un niveau des distances et des volumes, qui définissent le loin et le près, le grand et le petit avant tout « objet-repère » (l’échelle de la carte), cela veut dire que pour toute chose, et donc tout fait, qui, certes, pourraient être localisés sur un écran comme des éléments de mosaïque selon une projection coordonnée, il existerait aussi la possibilité qu’ils soient situés en rapport au « corps propre » du sujet qui les perçoit, selon une technique analogue au retournement platonicien vers l’extérieur de la caverneLa version ultime de ce retournement est proposée par Georges Didi-Huberman dans Phasmes – Essais sur l'apparition [1998]. Le chapitre « Celui qui inventa le verbe “photographier” » relate en effet l’histoire de Philotée le Sinaïte qui aurait vécu entre le IXe et le XIIe siècle de notre ère sur un escarpement du mont Sinaï (un endroit nommé Batos où, selon la légende, brûla le Buisson-ardent) : « Il cherchait désormais à noyer ses yeux dans le flot solaire ardent. Imaginant devenir image à se soumettre à la lumière. L’unique chemin, pensait-il, pour voir et être vu de quelque chose qu’il nommait “Dieu”. »… Ce qui n’est d’ailleurs pas sans danger, sachant que « la chose en soi », la « vérité » ou la « beauté absolue » peuvent aveugler le téméraire qui s’aventurerait à s’y exposer sans préparation, sans avoir parcouru par étapes successives, sans en omettre aucune, ce qu’il appelle « le chemin de l’amour ». Mais tout en allant vers le monde et ses dangers, l’être qui s’accorderait à son « corps propre » serait en fin de compte moins menacé de disparition que le cartographe qui persiste à confondre le réel et son image tout en étant persuadé qu’elle est « scientifique », ruines comprises, et il pourrait être, de plus, protégé de la noyade (et, incidemment, de Dieu) par ses fictions qui, en raison de leur caractère « imprédictible », peuvent être comprises comme une sorte de philosophie de l’esprit sans sujet (pensant), selon une formule inspirée de Martin Heidegger.
Topographie
Ce que la cartographie ne peut pas restituer, à savoir cette dimension d’enveloppement qui nous relie, nous et nos « circonstances » aux choses et aux faits qui se proposent comme des circonstances alentour, la topographie, en tant que description et représentation détaillée d’un lieu avec tous les objets qui l’habitent, le pourrait-elle ? On serait tenté de le penser à la lecture de la Topographie anécdotée du hasard [1962] de Daniel Spoerri : « Dans ma chambre numéro 13 de l’hôtel Carcassonne, 24 rue Mouffetard, au 4e étage, à droite de la porte se trouve une table entre le réchaud et l’évier que Véra m’a peinte un jour en bleu pour me faire une surprise. J’ai voulu voir ce que les objets qui se trouvaient sur la moitié de cette table, et dont j’aurais pu faire un tableau-piège, pouvaient me suggérer, et ce qu’ils éveilleraient immédiatement en moi en les décrivant ; […] À la suite de la description des objets se trouve un dépliant, dont la forme irrégulière est la même que celle de la table. (Voulant remplacer mon réchaud simple par un double-feu, j’ai dû en scier un morceau). Ce dépliant contient un relevé exact d’une topographie due au hasard et au désordre que j’ai arrêté le 17 octobre 1961 à 15 h 47. » Quatre-vingts objets se trouvent ainsi décrits dans leur situation et leur état, avec parfois des notes, « chaque fois qu’il existait un texte se rapportant à l’objet », et un long passage qui retrace une conversation « entre R. et D. vers le 7 octobre 1961 », « piégée presque par hasard sur magnétophone », dans laquelle s’est précisée l’idée de la « topographie ».
Après le texte, on trouve un index comportant soixante-quatorze références aux personnes citées (dont lui-même) qui sont aussi bien ses proches dans la vie courante que dans sa vie artistique, des auteurs ou des artistes anciens que des personnes n’ayant de rapport qu’avec les objets décrits, comme Pasteur (pour la pasteurisation du lait en bouteille). Et, pour terminer, le relevé cartographié à l’échelle 370/1000 est inséré sous forme de dépliant à la fin de l’ouvrage pour servir, selon le souhait de Daniel Spoerri, de point de départ à la lecture : choisir un tracé sur cette carte, et « chercher le texte s’y référant dans la brochure, sous le même numéro ».
Or, Pierre Restany, dans une lettre qu’il lui adresse le 30 décembre 1961, se focalise surtout sur le terme « anécdotée » : « Après examen approfondi du Grand Larousse Illustré en 7 volumes je te fais remarquer : 1° que l’orthographe “anecdoté, ée”, qui supposerait un verbe “anecdoter” (inexistant) n’est pas mentionnée, et qu’il faut donc la considérer comme un néologisme de ton invention, néologisme peu harmonieux au demeurant. 2° que le mot “anecdote” pris dans son acception primitive (du grec anekdotos) signifie “inédit” : je livre cette observation à ta méditation. 3° qu’il existe en revanche le mot “anecdotomanie” dont on peut très correctement tirer “anecdotomaniaque”, et qui signifie : manie de rechercher, de raconter des anecdotes. » Passons sur la première remarque, cette entrée en matière ne pointant l’incorrection lexicale que pour donner plus de relief au terme incriminé, comme confirmé dans la troisième. En effet, si beaucoup de choses et de faits peuvent exister sans faire l’objet d’une manie collectionneuse, choses dont, soit dit en passant, la consistance ne dépend de toute façon que très marginalement de leur représentation, l’anecdotomanie sélectionne précisément des faits en raison des circonstances qui y sont associées dans la perception. Ainsi comprise, l’anecdote contiendrait des circonstances externes et internes à celui qui la collectionne, et serait donc l’enveloppe historiée du groupement impliqué par toute proposition circonstancielle.
Postmodernité
La seconde remarque, rappelant que l’origine du terme « anecdote » est « l’inédit », est encore plus révélatrice du lien entre les faits et leurs observateurs, et, par extension, entre la circonstance et son centre : si l’on admet cette « traduction », l’inédit étant la chose ou le fait dont la description n’a pas été publiée, et peut-être pas même communiquée, la démarche de Daniel Spoerri relève, par anticipation, de ce « futur antérieur » dont Jean-François Lyotard avait fait l’emblème de la position postmoderne : « de ce qui aura été fait ». En principe, l’œuvre, comme le texte, devrait avoir les propriétés de l’événement et pourrait donc être « séparée » de ce qui ne la rattache que de manière anecdotique aux circonstances de son surgissement, l’événement étant précisément ce qui « s’arrache » de son contexte. Or, dans la condition postmoderne, les œuvres arrivent toujours trop tard pour leur auteur, ou, ce qui revient au même, leur mise en œuvre commence toujours trop tôt, comme le fait remarquer Jean-François Lyotard : « Postmoderne serait à comprendre selon le paradoxe du futur (post) antérieur (modo). » Et c’est ainsi que l’œuvre postmoderne ne serait pas en principe gouvernée par des règles déjà établies et, accessoirement, qu’elle ne pourrait pas être jugée au moyen d’un jugement déterminant, par l’application de catégories connues : « Ces règles et ces catégories sont ce que l’œuvre ou le texte recherche. » Pour cette raison, l’œuvre postmoderne adhérerait plus à la circonstance (dont elle serait le centre) que l’œuvre classique ou moderne, que, d’ailleurs, elle précéderait : « une œuvre ne peut devenir moderne que si elle est d’abord postmoderneIl faut prendre l’interprétation de Jean-François Lyotard au pied de la lettre : le postmoderne n’est pas ce qui succède au moderne, mais ce qui l’anticipe en tant que virtualité. Est moderne, en effet, toute innovation, « l’invention de soi » étant, selon Giovanni Lista dans La scène moderne [1999], le critère de l’art ainsi qualifié, et toute découverte n’étant que la rencontre fortuite avec une épave, c’est-à-dire avec une chose enfouie par sédimentation de poussières, de matières, ou de fragments de connaissances qui en ont recouvert les aspérités au cours du temps. Le moderne est donc l’actualisation de ce qui existait, en premier lieu de soi-même, et qui a été « oublié » par accident, perte ou naufrage, par dégradation « entropique » ou volonté délibérée d’enfouissement, voire de sabordage – toutes figures qui évoquent soit le délire paranoïaque soit l’égarement schizophrénique. Conséquemment, le surgissement du futur dans le « post » de l’art moderne désigne une réalité virtuelle : réalité puisque référant à une modernité déjà advenue dans le moment de son énonciation, et virtuelle par le pari de sa perpétuation. De plus, alors que la modernité se nourrit, et se satisfait, des accidents de l’expansionnisme, la postmodernité les programme et constitue cette doctrine en objet d’exposition, en œuvre, en art. ».
La Topographie anécdotée du hasard suit le schéma de la condition postmoderne de l’œuvre proposée par Jean-François Lyotard, ou plutôt elle l’anticipe si l’on compare l’année de sa parution, 1962, avec l’époque où ce dernier en élabore la structure : La Condition postmoderne : rapport sur le savoir paraît en 1979 et le texte d’où sont extraites les citations – « Réponse à la question : qu’est-ce que le post-moderne ? », in Critique – en avril 1982. Mais cela n’a rien d’anormal, car il faut bien que les œuvres existent, d’une manière ou d’une autre, afin de pouvoir être philosophiquement conceptualisées, c’est-à-dire faire l’objet d’une description, d’une catégorisation, d’une classification ou, surtout, d’une modélisationIl va de soit que l’on peut conceptualiser un objet non encore advenu, auquel cas on parle plutôt de simulation ou de prévision. Cette démarche dans laquelle le concept, plus ou moins influencé par ceux qui ont existé, est la source du modèle, se rapprocherait de la condition postmoderne. Mais il convient de distinguer la démarche de création d’un « art sur l’art » de la démarche scientifique d’élaboration d’une connaissance sur l’art en dépit du souhait de les confondre comme cela a été le cas avec Abraham Moles et sa figure de l’esthéticien-artiste.. Cependant, dans le cas d’une œuvre censément postmoderne, l’exercice est délicat car elle ne peut être conçue comme telle qu’au passé, dans un état qui n’est plus celui de son aperception. En effet, nous ne pouvons en avoir une claire conscience qu’au moment où elle s’est fait œuvre, simplement, et peu importe la catégorie dans laquelle elle s’est transmutée, classique ou moderne, car ce qui fait l’œuvre est avant tout ce qui, du processus créatif, s’est transmis. Ainsi, dans la tripartition du procès créatif imaginée par Daniel Charles, l’opus de la musica poetica, autrement dit la poïétique (Listenius), correspondant à la production (Aristote) ou au « réel » (Greimas), serait le centre immobile de toute création, comme une partition ou un tableau pourraient l’être pour une création musicale ou picturale au point qu’ils représenteraient, à eux seuls, « l’œuvre ». Par conséquent, au moment de sa réception, aucune œuvre ne serait encore postmoderne. On pourrait seulement dire d’une telle œuvre qu’elle a été postmoderne.
Procès créatif
Cette problématique est très marquée dans la « topographie » : si l’on en revient au rapprochement proposé par Pierre Restany entre l’anecdote et l’inédit, et sachant qu’elle a été publiée, éditée, et que, par cette opération, elle s’est fait opus, alors elle ne peut être catégorisée comme postmoderne qu’au passé, et en lui restituant sa part de « théorie et de pratique » (Listenius), de « savoir et de geste » (Aristote), de « virtuel et d’actuel » (Greimas). Néanmoins, la « topographie » de Daniel Spoerri, en montrant l’imprésentable dans la présentation elle-même, en se refusant à la consolation des bonnes formes et au consensus du goût, en exposant ce dont on ne peut jouir que pour mieux faire sentir qu’il y a de l’imprésentable, contient assez d’indices pour que, même dans la forme figée de sa publication, elle puisse encore être lue dans la dimension d’enveloppement qui signe la circonstance, et qui relie notre situation à celle de l’auteur « selon la circonstance », comme le dit Roland Topor dans sa préface à la réédition de 1990 : « la réalité objective ordonnée par le hasard étant finalement le plus sûr moyen d’obtenir une image ressemblante de notre vie ».
On devine donc qu’il s’agit d’autre chose qu’un autoportrait complaisant, réalisé au travers des reliques ou des vestiges du quotidien, et qu’il n’est pas davantage question de faire étalage de relations mondaines qui sont tout autant des « inventions » que celles des objets trouvés dans le métro, précisément qualifiés « d’épaves » dans les règlements affichés par la RATP, mais du même genre d’acrobaties qui furent réalisées par Georges Pérec dans ses tentatives d’épuisement du réel avec, notamment, Penser/Classer [1985]. Ce qui, par conséquent, est troublant, et ce qui permet le « mirage » postmoderne au-delà de ses nombreuses mutations, c’est qu’une proposition circonstancielle qui expose principalement de l’imperceptible puisse produire une impression esthétique : c’est comme si l’on pouvait avoir une émotion « sans objet », ou comme si l’on pouvait concevoir une philosophie de l’esprit « sans sujet »… Ce qui a été effectivement le cas avec Heidegger ou la cybernétique.
Certaines œuvres des nouveaux réalistes, ainsi que quelques-unes des artistes du mouvement « pop art », se présenteraient alors comme une surface aqueuse sur laquelle, selon l’angle avec lequel ils auraient été projetés, les rayons de nos regards se seraient enfoncés en profondeur et auraient été engloutis ou, au contraire, auraient ricoché suffisamment pour nous révéler notre propre condition humaine. Mais on ne peut pas dire de ces mouvements, ni de la condition postmoderne en général, que ce sont des propositions circonstancielles complètes, mais seulement qu’ils convoquent des circonstances ayant principalement rapport au temps, parfois à la personne, à la chose ou aux moyens, mais le plus souvent de façon séparée et pour servir des esthétiques dans lesquelles l’œuvre, en tant qu’astre fixe du procès créatif, reste en position dominante.
Dans la Topographie anécdotée du hasard, la topographie représente concrètement, par la carte dessinée en fin d’ouvrage, l’aspiration à « faire œuvre », et la publication de cet « inédit » en est l’instrument. On peut admettre qu’un « inédit » ne puisse être connu comme tel que lorsqu’il cesse de l’être, que « ce qui aura été fait » cristallise dans un objet précis, mais la topographie, toute détaillée et documentée qu’elle puisse être, et même si, dans certains cas, le détail et la documentation peuvent désigner cet « ailleurs » de l’entour circonstanciel, reste coordonnée. Pour ne pas l’être, elle aurait dû renoncer à tout support de structure algébrique, métrique ou ordonnée, elle aurait dû adopter un système de correspondance entre les objets sensibles fondé sur des notions qualitatives… Bref, elle aurait dû cesser d’être une topographie, ce en quoi consiste précisément le projet de la topologie.
Circonstanciel sonore
C’est à ce moment de la réflexion sur le thème de la circonstance qu’il peut être utile de substituer aux objets qui sont perçus par le sens de la vision ceux qui sont perçus par le sens de l’ouïe. Il n’est pourtant pas question de les tenir séparés dans la perception, en étendant la démarche scientifique appropriée à la description des diverses formes d’énergie qui stimulent nos organes sensoriels à celle de la perception elle-même, qui ne se représente la réalité qu’au moyen d’une certaine utilisation de ces organes sans qu’on puisse en démêler les modalités. Néanmoins, les caractéristiques du sonore et la manière dont il contribue à notre représentation du monde le situent dans une position nodale.
En effet, on range habituellement la vue et l’ouïe dans la catégorie des sens « de la distance », et le tact, le goût et l’odorat dans la catégorie des sens « du contact ». Mais si, pour le tact et le goût, la catégorisation traditionnellement proposée ne fait pas trop question, si l’on peut encore admettre que l’odorat est excité par des molécules, donc par contact, et si, parallèlement, l’aspect ondulatoire de la lumière peut faire pencher en faveur d’un sens « de la distance », le cas du son est plus ambigu car, en termes physiques, tout se résout au niveau du tympan où les molécules de l’air viennent « frapper » comme à une porte, bien que ses « sources vibrantes » en soient effectivement distantes.
Ce statut « d’être double » est reflété dans le spectre des théories sur le son : la théorie des « qualia », en tant que propriétés de l’expérience sensible, laisse ouverte la question de leur existence et de leur nature ; la théorie physicaliste « classique » qui, tout en refusant de considérer les sons comme des qualités, les identifie aux ondes sonores dans un milieu, néglige la possibilité que les sons soient des perturbations d’un certain type dans l’objet qui en serait, en un sens, l’acteur ou le jouet ; la théorie dite « événementielle » qui estime que le son nous renseigne d’abord sur la composition des objets et leurs matières, ce qui peut être résumé par le terme de « structure interne de l’objet », identifie les sons à des événements dans l’objet résonnant en faisant abstraction de la « résonance » du sujet sensible, donc de ce qui s’y passe et qui est aussi de l’ordre de l’événement.
D’autres théories peuvent exister, ou pourront être élaborées, mais aucune ne pourra jamais échapper à la nécessité de transformer d’abord son sujet en objet ; car toute science est un système de connaissances où un ordre de faits déterminés est coordonné et ramené à des lois. Le « fait construit » est, par conséquent, l’âme véritable de la méthode scientifique, et il en résulte un rejet de « l’être essentiel » de ce « fait » qui est, justement, une mise à l’écart de son sujet. Or, avec le phénomène sonore, cette complication inhérente à toute science est spécialement contrariante, puisque le son et l’écoute entrelacent le « son apparaissant » et « l’apparaître du son ». En contrepartie, dans ce dédoublement, la figure d’un son « déphasé » de lui-même est assez appropriée à l’exploration de cet autre schéma de « disparation » qui a été repéré dans la circonstance.
Le son et l’écoute
Le son est un « être » séparé : comme un « atome » nous apparaît selon diverses modalités, matérielle, ondulatoire ou métaphysique, en fonction de l’expérience qui le manifeste, le son (nous) apparaissant dénote un « apparaître » qui dépend de postures d’écoute plus ou moins stéréotypées. L’examen de ces préjugés qui organisent par conformisme la dialectique des « images » manifestes et scientifiques du monde montre en quoi le discours et, plus profondément, le langage, sont des emprises… C’est-à-dire séquestrent ce qui est et ce qui s’éprouve dans des carcans et des camisoles qui sont, à proprement parler, nos œuvres. Pour le dire avec Antonin Artaud : l’homme a choisi de « faire caca » ; ou avec Michel Foucault : l’homme a rejeté la folie, ce qui a impliqué son consentement à l’ouvrage, au travail, à la torture. Ainsi, l’œuvre du langage est moins le produit de notre humanité que son enveloppe : drapeau qu’il s’agit de défendre sur le champ de bataille alors même que tout est mort autour, et qui peut accessoirement servir pour étouffer ceux qui bougeraient encore. Or justement, ce qui agace avec le son, une fois qu’on lui a appliqué des théories à tendance physicaliste, phénoménologique ou métaphysique, c’est qu’il persiste bien qu’il n’ait pas vraiment le rang d’être.
De fait, l’homme ne consent pas facilement à perdre l’être, ce qui équivaudrait pour lui à accepter de mourir vivant, du moins à admettre sa folie. Il y a dans l’être quelque chose de particulièrement tentant pour l’homme, qui est justement le savoir qui s’exprime par oriflammes et bannières, par emblèmes et allégories… Et par un goût de la certitude qui en est l’expression la plus voyante, étant par ailleurs indissociable d’un goût de la servitude. Et cette tentation qui se repère dès notre plus jeune âge et se signale par tous les « pourquoi » dont l’adulte ne se débarrasse vraiment que par autant de « c’est comme ça » qui esquissent la contingence et l’arbitraire sans les assumer, ne peut, de ce fait, qu’être indéfiniment reconduite par l’homme « formé » qui exprime toujours le besoin d’une autorité qui, en échange d’un aveu de soumission, se porte garante de la vérité sans pour autant, cela va de soi, en rien révéler.
L’absence d’œuvre serait, par conséquent, la forme la plus générale, et en même temps la plus concrète, de la folie, de manière intermittente avec le coitus interruptus de Jacques Rigaut, ou définitive avec la vasectomie de Jacques Lizène, et sans égard pour la contradiction ou l’incompatibilité : « devenir enfant » pour Jean Cocteau ou « devenir son propre tube de peinture » pour Jacques Lizène. Dans cette approche « schizologique », la merde ne serait pas là où ça sent, mais pourrait être soupçonnée partout où son odeur a été masquée par celle des théories. Et comme aucune doctrine ne pourrait avoir la capacité de dissolution chimique des désodorisants industriels sans perdre son essence, sans s’évaporer au moment même de son énonciation, les théories ne peuvent que faire religion et proposer une thérapie, comme avec l’imposition des mains par laquelle sont signifiés le don de « l’esprit saint » et le rétablissement de l’homme… Mais de quoi la théorie prétend-elle nous guérir ?
Fétichisme
Que faut-il guérir, en effet, et quelle urgence à soigner ? Ce qu’il faut guérir, c’est le réel qui résiste à se réduire à ce quasi-néant que Platon nommait le « moindre être » (méon) propre aux choses sensibles censées n’exister qu’à demi et à peine. Et puisque le son est « en même temps » là où apparaît l’événement et là où ses conséquences se manifestent, puisqu’il est, pour ainsi dire, ubiquitaire, en rupture avec le sens commun de la causalité, il constitue une telle menace, il n’est plus « simplifiable », sauf par abus d’approximations dans la résolution de son « équation » : par exemple celle « des cordes vibrantes » par d’Alembert en 1747. L’urgence à soigner, de toutes les époques depuis l’Antiquité, est, quant à elle, induite par l’omniprésence du son en tant que surgissement intempestif du réel, à la difficulté de le manipuler aussi aisément que les autres stimuli de notre perception. L’urgence, c’est encore d’éduquer et de normaliser la modalité auditive de l’homme en la ramenant à une fonction, en la soumettant aux « puissances de langage », selon la formule de Gilles DeleuzeNotons que, pour parvenir à cette normalisation, le moyen le plus efficient consiste à la déguiser sous un aspect « naturel », démarche qui sera, entre autres, celle d’Hermann Ludwig von Helmholtz : les « causes physiologiques de l’harmonie musicale » [1877] illustrent en effet l’idée d’une nature tutélaire, susceptible d’effacer toutes les singularités, toutes les contradictions, toutes les hostilités de l’expérience. La naturalisation de l’audition, ou sa « renaturalisation », qui sont en réalité des opérations de naturalisation de la culture, favorisent et légitiment le déni du réel. Le paradoxe se résout ici au moyen d’un paralogisme..
Or, pour cela, il suffit d’entreprendre l’analyse du son, c’est-à-dire sa mise en objet, puisque toute opération de réification contient virtuellement le « renversement anticopernicien », voulu par Edmund Husserl, en vertu de sa capacité à ramener le réel à cela qui est perçu – et en dépit de son projet d’individuation du réel. Par exemple, dans « l’écoute réduite » de Pierre Schaeffer, le son est effectivement mis en objet, mais c’est un objet, certes hylémorphique, qui n’existe que par ses déterminations formelles, en somme par des puissances de langage. Cependant, si la mise en usine et en boîte est désirée, ce premier désir se transcende aussitôt que la « machine » est assemblée et érigée en monument : sans qu’il lui soit nécessaire de l’abattre, pas même de tenter de la combattre, le désir biaise et se dépasse par l’hallucination perceptive et par une fétichisation « de second ordre », un fétichisme de l’écoute elle-même qui vient à point pour permettre à l’auditeur de s’échapper de « l’écoute autoritaire ». Cette action appuyée, comme tout fétichisme, sur le langage, laisse intact, en apparence, son édifice, bien qu’elle en mine quelque peu les fondations par corrosion.
Ainsi conçu, le fétichisme de l’écoute est un fétichisme de soi-même, créatif et jouissif, aux antipodes du fétichisme pathologique de Theodor Adorno qui le dénonçait, dans Le Caractère fétiche dans la musique et la régression de l’écoute [1938], comme un « mécanisme névrotique de la bêtise dans l’écoute », fondé sur un discours dégénéré, corrompu par le totalitarisme infantilisant de la publicité. Dans le fétichisme de l’écoute, Le discours y a pourtant sa part, n’étant pas simplement la manifestation ou la dissimulation des désirs mais aussi un objet de désir, n’étant pas seulement la traduction des systèmes de domination mais en même temps le pouvoir désiré. Si le discours permet de posséder et d’administrer le sensible jusque dans ses ultimes retranchements, s’il est capable de contrôler l’écoute jusqu’à en faire une forme de surdité, il est également la matière agissante des « déterritorialisations » par lesquelles une « science de ce qui est tout autre » – une « hétérologie » – peut restituer la texture indéterminée, indistincte, imperceptible, liminaire, de l’écoute.
La « désidentification » induite par l’informe sonore n’est, à cet égard, qu’une expérience parallèle, analogique à celle qui se joue dans la rencontre de « l’autre », « ami-amant », qui n’a jamais lieu, aussi paradoxal que cela puisse paraître, que dans le pouvoir du langage, donc dans la répétition du « même » : « Mon corps, celui de l’Autre, la Nature, l’Espace, se font lumière, jusqu’à l’insaisissable, l’imperceptible soudain se révélant. » André Almuró ayant interrompu la manufacture musicale en retrouvait, dans ce fragment de texte, la poésie comme « ready-made », dans un « enfantinage » férocement opposé à l’enfantillage des « machines répressives ». Le « je », et l’écoute, « moléculairement », diffusent. On ne redevient certes pas enfant, l’entropie, qui, en quelque sorte, matérialise le temps, en interdisant la réalisation autrement qu’en rêve, mais rien ne s’oppose à son devenir, en chaque être qui s’élève au rang de « machine désirante », qui s’exerce au « tout-autre » : l’enfant, le sauvage, la bête et le « bricoleur », enfin, qui résume, pour Theodor Adorno, la folie de tout désirOn pense bien sûr à Arthur Schopenhauer dont l’ouvrage princeps, Le monde comme volonté et comme représentation [1818], expose l’inévitable souffrance de toute vie humaine qui s’écoule « entre les désirs et leurs réalisations » : tourment du désir non accompli, désolation du désir assouvi. N’accablons pas Arthur Schopenhauer d’avoir écrit toutes ces pages pour simplement exprimer une angoisse de la mort que nous partageons tous, mais disons que le « tout-autre » et, particulièrement, le « devenir-enfant », proposent un cheminement qui n’est pas du tout une recette ou l’affirmation d’une nouvelle certitude, mais une voie d’éternité qui, instant par instant, « trompe la mort ». Ce serait un épicurisme revivifié, débarrassé en tout cas de son exégèse, serait-ce celle de Paul Nizan dans Les chiens de garde [1932] ou de ses plus récents commentateurs, comme Michel Onfray dans sa « Contre-histoire de la philosophie » qui sent un peu trop le désespoir et la haine de « l’autre » : signature cryptée, mais efficace, d’un populisme qui va tout à l’encontre de son exposé des Cynismes [1990] dont il semble avoir oublié la leçon « d’impertinence »..
Bruit de fond
Pour approcher le circonstanciel par le sonore, pour dépasser une topographie trop liée au visuel, il ne faut pas commencer par des objets qui pourraient encore être décrits comme des événements, qui pourraient être juxtaposés, et donc détachés, sur un plan. Il faut au contraire s’engager dans la profondeur du sonore jusqu’à l’imperceptible, jusqu’à l’inaperçu, jusqu’au bruit de fond qui constitue l’environnement du monde intelligible de même que notre activité neuronale constitue notre environnement perceptif en l’absence de tout stimulus sensoriel. Car privés de toute stimulation sonore, les récepteurs cochléaires n’en développent pas moins une activité spontanée, de fréquence instantanée très variable, jusqu’à ce qu’une stimulation apparaisse et provoque son augmentation et sa synchronisation sur le stimulus. Évidemment, cette observation scientifique à propos de la mécanique « neuro-sensorielle » ne doit pas nécessairement induire sa transposition, par analogie, dans le registre des phénomènes qui en sont les stimulus. Pour autant, il serait inconséquent de ne faire aucun rapprochement entre des phénomènes qui ont tous été décrits comme des bruits de fond dans des domaines aussi variés que la cosmologie, l’acoustique ou la biologie… Sans compter la théorie de l’information qui tend à les subsumer sous le principe unificateur d’une métalinguistique. Pour cette raison, le bruit de fond, ou ce que nous pouvons décrire sous ce label comme traces et origines inscrites dans l’ensemble des phénomènes observables, perceptibles, et aussi dans la perception en tant que phénomène, pourrait être le point de départ et le centre de déploiement de la circonstance.
Dans l’émission « Le bruit de fond », diffusée sur France Culture le dimanche 13 septembre 1998 dans le cadre d’un Atelier de Création Radiophonique, Jean-Luc Guionnet estime ainsi que si le bruit de fond est perçu comme arrivant au corps, il est aussi perçu « comme s’étant propagé jusqu’au corps au travers d’un milieu dont il porte l’empreinte quand il arrive ». Sa singularité, par rapport aux bruits dont on peut identifier les sources, ou les causes, serait d’être perçu comme « touchant » le corps et comme venant d’ailleurs, « en arrivant de tout autour ». C’est cette dernière formule qui pourrait rappeler la circumstantia. Et d’ailleurs, sans évoquer directement la circonstance, il complète sa description en indiquant quel est le centre du bruit de fond : le corps qui, nous dit-il, se trouve ainsi situé dans l’espace, et coordonné « de toute part, de toutes les distances parcourues par le bruit de fond. » À ce point de son analyse, il lui aurait été possible de nuancer son propos, ou simplement d’adopter une position plus problématique à l’égard de sa conception de l’espace, en l’espèce comme espace métrique. Mais il manque cette voie qui aurait pu l’amener sur le terrain d’une topologie : « Autrement dit, le bruit de fond perçu se rapporte à la position spécifique du corps dans l’espace physique, c’est-à-dire l’étendue. La perception du bruit de fond signe donc la position du corps dans l’espace, elle en implique la signature sonore. De là, une généralisation possible de cette signature de l’étendue : chaque point de l’étendue, comme autant de points d’écoute possibles, est signé par un bruit de fond spécifique. »
On voit que si, selon lui, le bruit de fond nous fournit, plus que tout autre phénomène, l’occasion d’une description directe de notre expérience, et sans égard à sa genèse psychologique ni à aucune explication causale, si le bruit de fond lui donne ainsi l’occasion d’une approche tendanciellement phénoménologique de la perception, dans laquelle le sujet est la source absolue, dont l’existence ne vient pas de ses antécédents, de son entourage physique et social, mais va vers eux, et les soutient, il subsiste chez lui une tentation « physicaliste » qui s’exprime dans le fait qu’il dresse une carte de toutes les écoutes possibles, donc une sorte de « Carte de l’Empire ».
Topologie
Pour que la formule initiale de l’émission de Jean-Luc Guionnet ne débouchât pas sur ce réductionnisme, il eût fallu qu’il tînt compte de deux choses : premièrement, que l’hypothèse selon laquelle l’étendue sonore est assimilable à un espace muni d’une structure algébrique, métrique ou ordonnée, n’est pas vérifiable à partir de l’expérience sensorielle, la perception n’étant pas une science du monde, pas même un acte ni une prise de position délibérée, étant au contraire le fond sur lequel tous les actes se détachent, et présupposée par eux, et, parallèlement, l’espace étant l’interstice entre les choses, que nous ne le percevons que parce qu’il y a des choses mais que nous ne l’éprouvons pas pour autant comme une chose car il est pour nous sans dimension ; deuxièmement, que le bruit de fond ne se révèle comme tel à notre perception, ne devient clairement perçu, que lorsqu’un événement, un objet sonore identifié venant à se fondre, justement, dans cette ambiance, le « sentir » se trouve, en quelque sorte « amplifié » par l’action de l’attention qui a été portée sur cet objetIl est bien possible que ce phénomène perceptif ait un fondement organique dans nos circuits neuronaux car on a repéré, dans les centres auditifs de nos cerveaux, des neurones qui sont sensibles au changement et qui pourraient, par conséquent, déclencher cette « amplification » sensorielle, mais il est peut-être encore plus intéressant de remarquer qu’il pourrait généraliser certaines observations qui ont été faites dans le cadre des théories gestaltistes et qui étaient présentées comme des singularités, voire comme des illusions : il s’agit de ces images ambiguës qui, par inversion de la forme et du fond dans la perception, permettent de voir deux objets possibles. Si certains mécanismes neuronaux agissaient effectivement comme dans cette hypothèse, alors il n’y aurait plus à distinguer entre la forme et le fond. Toute image pourrait être ambiguë et l’étiquette « bruit de fond » ne désignerait que notre tendance à stabiliser l’image du monde, donc notre propension à nous situer dans le monde au moyen d’un mécanisme d’inhibition du mécanisme par lequel nous percevons le changement..
Cette dernière objection suffit, cependant, pour établir l’intérêt d’une approche topologique. En effet, l’émission de Jean-Luc Guionnet commence par un grand coup de gong, puis son énergie acoustique qui s’amenuise laisse peu à peu entendre l’ambiance sonore qu’il avait d’abord masquée. Et il explique justement que, chaque fois qu’un événement sonore vient à se fondre dans son « milieu », notre perception devient sensible à ce milieu d’où il a d’abord surgi. Mais le renversement ontologique suggéré par ce montage sonore, dans lequel la perception n’aurait plus pour fonction de permettre au sujet d’envisager le monde, mais de s’envisager par un monde qui serait, selon la formule de Maurice Merleau-Ponty « cela que nous percevons », et où il trouverait sa position, n’est pas effectif : notre expérience habituelle ne comprend qu’exceptionnellement le « coup de gong », encore moins l’amplification progressive de l’ambiance acoustique du lieu où il est produit, et nous sommes plutôt organisés pour détecter des événements dans le bruit – c’est ce que les psycho acousticiens ont nommé le « démasquage binaural ». Jean-Luc Guionnet n’est probablement pas dupe de sa manipulation qui, comme toute expérience, est un « fait construit » pour valider une théorie et, d’ailleurs, il préfère « oublier » la condition initiale du coup de gong et sa singularité dans la suite de sa démonstration. Pourtant, si le bruit de fond a émergé, au-delà de l’artifice de son amplification électronique, c’est bien parce qu’un événement singulier et initialement « masquant » a migré d’une position principale vers une position secondaire, donc circonstancielle, et que cela a provoqué la migration symétrique, dans l’audition, de l’entour contingent et initialement « masqué » vers la position de fait principal.
Il eût suffi que cet événement initial ne fût pas escamoté (dans son discours) pour que la topologie advienne, pour que la proposition circonstancielle de ses « entours secondaires » s’active au prix, il est vrai, d’une perte de sa substance et d’un échange de fonctions entre « événement » et « circonstances » qui auraient quelque peu malmené le jeu de rôle des objets assignés dans son énoncé, qui auraient surtout sapé la doctrine fonctionnaliste qui la sous-tend. C’est un peu comme si la seule chose qui importait pour Jean-Luc Guionnet était de trouver place dans l’espace géométrique, dans l’espace abstrait des idées, en substituant aux relations labiles et évolutives, que nous avons tous avec notre monde, le système quantique et relativiste de chacun de ces points « signé par un bruit de fond spécifique »… Système dans lequel nous ne serions en effet, tous autant que nous sommes, que des « points » géométriques privés de toute capacité d’agir, sans force, sans subjectivité. Après tout, ce relativisme radical est bien tentant : aucune force ni aucune énergie particulière ne sont requises pour se fondre dans ce grand tout indifférencié, et le principe d’équivalence de Robert Filliou ou celui d’une abolition de la valeur sont sûrement moins douloureux à expérimenter que ne l’est la « transvaluation » nietzschéenne, sans même compter l’effort de compréhension requis par cette notion de renversement, voire d’inversion, de toute valeur.
C’est là qu’il faut en revenir à l’étymologie car, si la circonstance existe, c’est précisément parce qu’elle émane d’un centre subjectif qui, d’une certaine façon, en est l’énergie créatrice et le centre de déphasage qui « l’individue » dans le mouvement analogique et parallèle de notre propre individuation, du moins dans celui de notre pensée. Dans Malone meurt, l’acteur central du roman de Samuel Beckett entreprend la recension des objets qui lui appartiennent et qui sont dans la chambre qu’il occupe. Les seuls objets qu’il « possède » ne sont, cependant, pas ceux que la chambre contient, mais ceux dont il peut se saisir avec son bâton… Et lorsque cet instrument lui échappe, tous ces objets disparaissent. C’est comme s’ils n’avaient jamais existé, alors même que le « crayon français » qui est censé être « quelque part » dans son lit, dont il pourrait avoir besoin, « mais pas encore », prend consistance et devient, si l’on veut poursuivre l’idée de la topologie, une circonstance avec laquelle son « œuvre » prend, elle-même, consistance comme un ciment en présence de son catalyseur ; son œuvre qui est « circonstanciellement » celle de Beckett.
Pause circonstancielle (aparté)
Si je voulais être philosophe, il me faudrait bien sûr connaître la philosophie, son histoire et ses systèmes, et il me faudrait m’exercer à en médiatiser la matière. Mais cela ne ferait pas plus de moi un « philosophant » qu’un bon élève de la Comédie Française ne fait un « actant », c’est-à-dire un être dont la vie est de même matière et texture, de même animation, de même forme, et de même « énergie » que son art… À supposer que l’art puisse être sur le même plan que l’homme, où que l’homme puisse être sur le même plan que l’art. Pour le philosophant, il ne suffit pas d’inventer des concepts, des idées générales qui ne seraient même pas absolues ni nécessaires. On n’invente jamais que des épaves, que des objets naufragés, perdus ou abandonnés. Ce qu’il faudrait faire, pour être philosophant comme on est enfant (infans), c’est-à-dire la source d’un langage à venir, ce serait établir « les règles de ce qui aura été fait », ce serait épouser le « paradoxe du futur (post) antérieur (modo) », ce serait, en somme, être « postmoderne » selon la définition que Jean-François Lyotard propose pour ce qui se donne moins comme une période historique que comme une attitude face au monde.
Ombilic
François BotulUn surprenant homonyme de ce philosophe de fiction, auteur de La vie sexuelle d’Emmanuel Kant, inventé par Frédéric Pagès et popularisé, bien involontairement, par Bernard-Henry Lévy., par exemple, refuse « la consolation des bonnes formes », le « consensus d’un goût qui permettrait d’éprouver en commun la nostalgie de l’impossible » (cf. Jean-François Lyotard), ce qu’on pourrait appeler le soulagement esthétique : son installation Ombilic, qui est constituée par une sorte de cordon rigide, noir et luisant, comme enduit de graisse, et terminé par un bulbe sonore, sort du mur comme une excroissance organique qui débande. À La Ferme du Buisson, le 8 novembre 2008, elle était accessible par une porte au côté de laquelle était placé un cartel sur lequel étaient juste écrits le nom de l’auteur et le titre de la pièce, la « sculpture » étant montée à l’extrémité d’une coursive d’environ huit mètres, bordée à droite par un mur noir et à gauche par un garde-corps métallique protégeant un vide, l’espace au dessous n’étant pas éclairé.
Une fois la porte franchie, le visiteur voyait « l’ombilic » faiblement éclairé par une petite lampe et entendait un son ténu, aigu, le tout à la limite des seuils de perception. S’il restait sur place, au bord de l’installation, rien ne changeait. S’il s’avançait, pour mieux voir et mieux entendre, presque rien ne variait non plus, car le volume du son était réglé, par capteur et programme, en proportion inverse de la distance qui le séparait de la sculpture. Au sortir de cette installation, j’imaginais que l’éclairage de la sculpture eût pu être synchronisé avec le volume du son pour accentuer le sentiment de « l’imprésentable dans la présentation elle-même », pour encore mieux « humilier et disqualifier la réalité » (cf. Jean-François Lyotard), mais, après réflexion, j’admettais que cette disposition aurait induit deux risques : l’un, très concret, de mettre le visiteur en danger de tomber dans le vide, et l’autre, plus hypothétique, de rendre l’installation trop explicite, trop « lisible ».
Ce « générateur de frustration », comme François Botul qualifie sa sculpture, agissait presque à tout coup : pour le visiteur à l’audition « normale », il y avait déjà une mise à distance du fait de l’interaction uniquement sonore qui entravait le genre de sensorialité généralement recherchée par les environnements « immersifs » dans lesquels le « jeu » n’a d’autre fonction, apparemment, que de valoriser sa présence tout en établissant encore mieux le statut de l’artiste producteur, et ce, bien que le dispositif de « l’ombilic » ne puisse pas être considéré comme entièrement fermé à l’expérience perceptive ; pour le visiteur plus âgé, possiblement atteint de presbyacousie, l’installation se présentait encore plus franchement selon un schéma de même allure que celui de la pièce À bruit secret de Marcel Duchamp : « Tel est le titre de ce ready-made aidé : une pelote de ficelle entre deux plaques de cuivre réunies par quatre longs boulons. À l’intérieur de la pelote de ficelle, Walter Arensberg ajouta secrètement un petit objet qui produit un bruit quand on le secoue. Et à ce jour je ne sais ce dont il s’agit, pas plus que personne d’ailleurs. » Avec Ombilic, c’est bien une formule de « désappropriation » qui est proposée, même si le tabou n’y est pas aussi explicite qu’avec À bruit secret.
Interdit
Marcel Duchamp, en effet, expose l’interdit en tant que tel car, pour ajouter ce petit objet, la pelote ne pouvait pas être nouée et, de plus, on a du mal à croire qu’il ne l’a pas secouée. Avec son Ombilic, François Botul est moins direct, moins dialectiquement exclusif, mais peut-être pas moins vicieux : le visiteur n’était pas astreint à l’immobilité, à l’inaction, puisqu’il pouvait parcourir l’installation aussi longuement qu’il le souhaitait, et pouvait même tenter de « piéger » le mécanisme interactif en rasant le mur ou le sol, ou en se déplaçant très rapidement, ou, à plusieurs, en créant des leurres… Il n’empêche que son « devenir objet » n’était pas moins assuré que celui du visiteur d’À bruit secret car il finissait toujours par écouter ou tenter d’écouter, ou tenter de voir ce qui était donné à ne pas voir, et, ce faisant, se fixait comme un chien en arrêt : tous sens en éveil, mais quasi-cadavre sur la table d’opération de l’art.
Mais on ferait fausse route si on concluait sur cette impression négative, en ne considérant que l’aspect agressif de cette installation. Comme le dit François Botul dans sa thèse, il y a un « fétichisme qui est constitutif de l’écoute en tant que celle-ci est essentiellement une surestimation du sonore ». Il n’est pour lui nullement question de débusquer un fétichisme pathologique, mais seulement de mettre en branle notre imagination par une opération « transductive », parallèle, analogique à la sienne en tant que « facteur » de ce dispositif. Pour paraphraser Gilles Deleuze, il faut donc plutôt se demander quelle est la production de volupté de cette « machine désirante », de cette « machine-source » sur laquelle se branche notre « machine-organe » comme une bouche couplée à un sein, mais en écartant toute réduction à l’œdipe et à sa fonction répressive. Car cette piteuse triangulation géométrique n’engendre, en effet, le plaisir ou la douleur que dissociés dans une causalité appauvrie par son incapacité à envisager leur concomitance, ce pourquoi elle ne peut être que tyrannique, tandis que la machine qui hésite entre l’attrait et le retrait, entre la succion et l’expulsion, est « excessive » d’être là où l’excès n’est plus autorisé, parce que dépassionné.
L’intime tissage du plaisir de la raison et de la douleur de l’imagination – ou l’inverse – ne peut s’éprouver dans la passion, dans ce goût pour l’illusion ou l’absence d’objet qui ne s’accomplit jamais mieux que dans la dépression, mais doit au contraire entreprendre la réification, la fétichisation, doit machiner et se machiner par leviers, rouages et moteurs de toute sorte, et tant pis si, comme le dit Gilles Deleuze en commentant Samuel Beckett, « une machine infernale se prépare ». La « surestimation du sonore » est une modalité de l’écoute que l’installation Ombilic favorise sans l’imposer : « C’est ainsi qu’on est tous bricoleurs ; chacun ses petites machines. » Dans L’Anti-Œdipe [1972], la production de volupté ne résulte pas d’une « culture » ni d’une « structure », mais d’une « machine complète » constituée de pierres, de poches et d’une bouche qui suce ces pierres : une nouvelle entité. La question de l’art dans la thèse de François Botul est de savoir s’il est possible de se brancher sur une telle machine, et comment.
Pessimisme
En thèse générale et dans la majorité des pratiques artistiques, qu’elles soient conçues selon la valeur d’usage ou la valeur d’échange, tous les moyens sont bons pour masquer, fut-ce provisoirement, notre fin inéluctable, et surtout notre impuissance à en contenir le progrès : tous les emplois contradictoires, les appropriations, les empiétements d’un art sur un autre et, finalement, l’immersion dans des « réalités virtuelles »… Pourvu que cela distraie l’attention. Bon nombre de productions contemporaines épousent cette cause et le travail intellectuel, critique ou philosophique, suit ce mouvement, quand il ne l’anticipe pas.
Mais François Botul joue une autre partition. Ombilic tend, en effet, à dévoiler la double fonction des choses, toute réalité, à commencer par celle des organes, ayant son côté monstrueux, abject, scandaleux, et il y parvient par « l’exposition » et « l’installation » d’une débandade, d’une débâcle, d’une anarchie, qui en sabotent la forme convenue. Cette opération de déclassement a une valeur « performative » tout comme l’informe de Georges Bataille, puisqu’elle consiste à interdire l’assimilation des objets par l’altération des grilles de lecture ou des structures d’exposition, puisque, dans ce mouvement, elle restitue éventuellement aux choses une substance et une signification repoussées avec horreur par le formalisme moderniste, comme déjà par l’idée d’autonomie de l’art dans l’esthétique kantienne ou hégélienne.
Or, si le pessimisme qui a été révélé par l’informe a de préférence prospéré dans une certaine manière de décadence, en se moquant de la prétention et de la tendance grandiloquente de l’art « moderne » comme, auparavant, d’autres décadences se sont gaussées de celles de l’art « classique », si Georges Bataille a effectivement réactualisé l’idée de l’irréductibilité de la signification en récusant sa contamination obscène par des formes pures, cela ne concerne qu’indirectement certains « artefacts » qui, d’ailleurs, ne prétendent pas à toute force accéder au rang de substances ou de significations « essentielles » : « L’informe et l’imperceptible comme imprésentables. Ne pas donner à entendre ou donner à ne pas entendre. L’impossible d’un corps monstrueux, monstrueux justement du vide qu’il recèle ou même, “L’Angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie” (Artaud) ». Dans sa note préparatoire à l’installation Ombilic, François Botul indique ainsi clairement qu’en référant à l’informe, il ne s’inscrit pas pour autant dans un schéma qui le relierait obligatoirement au pessimisme et à la décadence, mais plutôt à une certaine manière de vacuité. Sa référence à Artaud n’est certes pas un signe d’optimisme, mais l’angoisse, en serrant cette corde, est aussi ce qui nous permet de nous sentir vivant. On n’est pas tout à fait dans l’ataraxie épicurienne, mais pas encore mort… Juste à demi conscient d’en être sur le chemin.
Vacuité
En effet, tout se passe comme s’il avait voulu que son installation ne fût pas visitée : le choix du lieu d’implantation, derrière une porte et signalée par un minuscule cartel dans le vaste espace d’un studio où se déroulait une performance bien mieux conçue pour capter la curiosité… Puis l’obscurité, une chose vaguement aperçue, d’apparence quelque peu répugnante, un son monotone et, de plus, très aigu, inaudible pour cette raison par toute personne ayant dépassé un certain âge en raison du vieillissement de l’ouïe. Il n’y avait donc pas grand-chose pour attirer l’attention, et pas non plus de quoi la retenir : le minimum de sensation. Ce n’est que par la citation, et comme au second degré, que le schéma décadentiste était suggéré : par allusion et non dans l’affirmation d’une exposition ou d’une installation qui, justement, n’existent idéalement que comme des autels religieux, des espaces cultuels ou régaliens.
Et d’ailleurs l’auteur n’était pas non plus présent, comme cela est pourtant assez fréquent dans ces « installations » dont les créateurs veulent s’assurer qu’elles seront « reçues » conformément aux modes d’emploi qu’ils ont prévu, qui veulent d’abord qu’il y ait des visiteurs pour les compléter comme les derniers rouages de machines qui, sans eux, seraient « célibataires », en jouant les rôles qui leur sont assignés… Sachant que ces pulsions participatives recoupent fréquemment un goût pour la discipline. Car les visiteurs d’expositions ou de musées sont d’abord des consommateurs et, qu’ils aient réglé ou non un droit d’entrée, ils ne peuvent que vouloir rentabiliser leur démarche. Mais cette sculpture, par son faible « rendement », les privait de tout alibi, de toute justification, de toute raison d’être là, de s’être déplacés, d’avoir investi la moindre énergie.
Cela permet de lever une ambiguïté qui pourrait subsister quant au sens de la démarche de François Botul. Effectivement, Marc Fumaroli, dans sa préface [1977] du roman À rebours [1884] de Joris-Karl Huysmans, propose le critère de « la mort » comme condition de « l’art décadent » : « La décadence, qui, alliée à la mort, décompose, fait de ses lentes agonies le moment chimique par excellence, où l’artiste, hâté par le temps qui presse, peut se livrer à des coagulations, catalyses, alliances et compositions surprenantes et inédites. L’éparpillement et le désordre rendent possibles des combinaisons nouvelles, selon un ordre différent et même opposé à l’ordre accoutumé. Le travail de la mort, pour l’artiste, devient la préface indispensable au travail de l’art “décadent”. » La préface de Marc Fumaroli renvoie à une autre préface : le travail de la mort indispensable, selon lui, à l’art décadent. Or, si la sculpture de François Botul évoque bien l’amenuisement des énergies, l’épuisement du son et de l’écoute, et même, si l’on veut, l’idée d’entropie, son issue indéfiniment reconduite épuise la mort elle-même comme source possible de son art. Si l’on devait, nonobstant, désigner son centre de rayonnement, il faudrait donc tout de même chercher du côté de l’ataraxie en ce qu’elle propose, précisément, le tarissement de cette angoisse par l’exténuation de tout ce qui ne relève pas des besoins justes nécessaires à l’entretien de la vie organique, autrement dit par l’épuisement des passionsIl faut ajouter à cela, bien que ce ne soit pas impliqué par la structure d’Ombilic, que l’orgie est tout aussi efficace que l’ascèse pour épuiser et consumer la chair. C’est du moins ce que pensaient les gnostiques. S’il n’est pas ici directement question de sodomie, ni même de fellatio, tous exercices pratiqués par les adeptes de ce mouvement pour dessiller les yeux aveugles de la chair, le couloir sombre, le trou dans la paroi d’où sort l’ombilic, sa conformation et sa débandade, ne peuvent pas, néanmoins, ne pas évoquer le sexe repu, ou reposé, sur le chemin de l’ataraxie..
De fait, sa référence à Antonin Artaud ne plaide pas pour cette « préface » : si le corps est « mal fait », et si Artaud en accuse la cause efficiente dans son émission Pour en finir avec le Jugement de Dieu (prévue pour être diffusée le 2 février 1948 dans le cadre d’un cycle intitulé « La Voix des Poètes » mais qui a été, la veille, interdite d’antenne par le directeur général de la Radio, Wladimir Porché), il ne s’attaque jamais qu’à « l’engendrement » qui prolonge la souffrance de l’homme et qui est la source véritable de son angoisse. Il déteste la mort, et aspire à « l’angélisme ». Il se serait en tout opposé à « l’installationnisme » actuel qui ne peut se passer de « l’autre » jouant le rôle du mort. Au moins, Des Esseintes, le personnage du roman À rebours, a le courage d’incarner lui-même cette fonction, mais, dans la plupart des cas, il y a délégation. La « place du mort », c’est-à-dire la « stalle » droite de « l’automobile de l’art », qui est la règle de l’installation contemporaine, n’est plus, avec Ombilic, qu’un strapontin dont la manipulation décourage l’emploi.
Jouissance
Une autre ambiguïté peut être levée, concernant la question d’un fétichisme « constitutif de l’écoute en tant que celle-ci est essentiellement une surestimation du sonore », car, effectivement, la réification n’est pas à tout coup le bricolage au sens de Theodor Adorno, c’est-à-dire comme la forme « la plus accomplie » de fétichisme, ce « puissant émerveillement que ressentent les enfants devant ce qui est bariolé », l’histoire de soi-même ou la fascination devant n’importe quel phénomène « instrumenté » dans une « nouvelle alliance » de la vie avec la science. Adorno aurait été bien embêté de devoir admettre que c’est l’écoute, et notamment l’écoute instruite d’un « art responsable [qui] obéit désormais à des critères qui sont proches de ceux de la connaissance : celui de l’harmonieux et du disharmonieux, celui du vrai et du faux », qui devrait plutôt être considérée comme constitutive et cause véritable d’un fétichisme morbide et régressif. L’écoute proposée par François Botul est plus proche de La pensée sauvage [1962] de Claude Lévi-Strauss, ne visant qu’à donner sens, « mythologiquement », à ce qui est, comme dans le poème de Parménide, et ne s’en démarquant que par son refus de la collectivisation de cet exercice, comme de celle du scientisme adornien.
Le fétichisme, dans la thèse de François Botul, est sans partage, ni dans sa version « sauvage » décrite par Claude Lévi-Strauss, ni dans l’interprétation que Theodor Adorno fait de « la connaissance pure, pure de tout vouloir, la jouissance du beau, le vrai plaisir artistique » qu’Arthur Schopenhauer proposait comme seule issue à la souffrance à laquelle nous serions nécessairement exposés, puisque cette connaissance, toute pure qu’elle puisse être, ne peut procéder que de théories qui, sous couvert d’universalité, ne dénotent que l’extrême rationalité du collectivisme, ne pouvant s’imposer que par la construction de faits qui, en retour, leur confèrent une certaine validité. L’exposition et l’expérience de la frustration renvoient dos à dos l’impuissance mythomane et l’imposture technologique. En effet, aucun désir n’est assouvi sans que cela engendre la satiété, donc l’ennui, et finalement un nouveau désir. Ombilic saborde le cercle vicieux de cette « machine passionnelle » en entravant l’oscillation entre souffrance et plaisir, en la freinant et en la réduisant – comme l’on dit d’une fracture – à un niveau subliminal, sans pour autant en faire « la plus heureuse vie » comme souhaité par Arthur Schopenhauer, c’est-à-dire en maintenant l’incompatibilité des forces en présence.
Ne subsisterait qu’un principe de jouissance et de profanation qui impliquerait, pour n’être pas qu’un jeu gratuit, une authentique forme de croyance, la profanation consistant, dans les termes de Des Esseintes (cf. Joris-Karl Huysmans), « avant tout dans une pratique sacrilège, dans une rébellion morale, dans une débauche spirituelle, dans une aberration toute idéale, toute chrétienne ». Partant de cette considération, la déraison consisterait justement en ce qu’il suffirait qu’il y ait quelque « vérité » à souiller pour que s’instaure une « joie analogue à cette satisfaction mauvaise des enfants qui désobéissent et jouent avec des matières défendues, par ce seul motif que leurs parents leur en ont expressément interdit l’approche ». Ces pratiques, fussent-elles « artistiques », ne pourraient vraiment proliférer, ne pourraient vraiment disséminer « comme une épidémie, comme la peste » d’Antonin Artaud, dans Le théâtre et son double [1964], que là où la désobéissance, la rébellion contre la religion, contre la loi morale ou esthétique procurent cette « joie mauvaise » des enfants qui arrachent les ailes des mouches avant de les écraser comme des araignées, comme autant de « circonstances aggravantes » du plaisir de la destruction qui en viendrait à se retourner contre elles par défaut ou défilade du sujet principal.
Décadence
Les formes décadentes ne pourraient donc pas être réduites aux signes manifestes que sont l’appropriation, le recyclage, les empiétements d’un art sur un autre, l’interactivité ou l’instrumentalisation du spectateur, le confinement à l’intérieur du sensible, l’éclectisme, le maniérisme… La décadence ne pourrait être authentifiée que comme le fruit de la destruction ou de l’anéantissement, entretenue et même engraissée par l’ennui ou le « désœuvrement ».
De fait, pour stimuler ses sens assoupis, Des Esseintes ne trouve convenable que les imitations, les artefacts, les simulacres « exténués », maladifs, aux apprêts grossiers comme des maquillages de prostitués, ou encore l’excitante saleté de la misère ; que les observations sans parti pris d’épisodes banals, les bestialités, les ruts dans tous les idiomes et vautrés à la même table, sans volonté de réforme, de satire ou d’intrigue, sans action, en somme la décrépitude d’un empire tel que le décrivait Pétrone… Ou la trivialité des circonstances.
Il distille du fiel, ou du venin, à l’état pur, montre une rage froide, hargneuse, un goût prononcé pour la canaille et, quand aux « œuvres », ne s’intéresse vraiment qu’à celles qui sont « mal portantes, minées et irritées par la fièvre », particulièrement dans la littérature parce qu’elle semble résumer tous les principes et les procédés de l’art décadent : « les œuvres de Barbey d’Aurevilly étaient encore les seules dont les idées et le style présentassent ces faisandages, ces taches morbides, ces épidermes talés et ce goût blet, qu’il aimait tant à savourer parmi les écrivains décadents, latins et monastiques des vieux âges ».
Mais le désœuvrement de François Botul n’est pas exactement cette décadence, étant antinomique à tout système de croyance, à toute religion, dont la « double contrainte » est une perversité qui déchaîne le goût de la destruction, même si elle ne s’épanouit paradoxalement que dans sa transmission, dans son engendrement, dans sa perpétuation, comme autant de signes « indestructibles » de l’immortalité convoitée. Michel Foucault en exprimait justement l’inversion dans sa préface à la première édition de Folie et déraison - Histoire de la folie à l’âge classique [1961] : « Qu’est-ce donc que la folie, dans sa forme la plus générale, mais la plus concrète, pour qui récuse d’entrée de jeu toutes les prises sur elle du savoir ? Rien d’autre, sans doute, que l’absence d’œuvre. » Admettons qu’il ait lui-même surtout voulu contester l’Institution du Savoir et qu’il se soit servi du thème de la folie dans ce but. Il reste que la réification des productions des fous, comme « art brut » par exemple, indique assez l’absence de l’Œuvre. Cette absence est le contrat rompu qu’aucun objet – fût-il celui d’un culte, comme avec Marcel Duchamp et quelques autres – ne peut compenser, sinon dans la forme la plus avilie de fétichisme, celle qui abandonne la dignité du « fétichisme de soi-même » comme authentique espace vide où tout est possible.
À front renversé
Ce qui est, ou se tient, autour, ne saurait, dans le même temps, être dans l’œuvre qui est le centre réel de tout ce qui se tient potentiellement à son entour. Nulle circonstance ne peut énoncer autre chose que des conditions indéterminées d’une œuvre inatteignable, et sans pouvoir rien transmettre que la fugacité du moment. Le pluriel de la circonstance, comme « nombre » des faits particuliers et secondaires qui gravitent autour d’un événement principal, n’a pas d’autre fonction que d’en révéler l’inconsistance et l’impuissance, tout comme les circonstances atténuantes ou aggravantes n’ont pas d’autre emploi que celui de légitimer la médiocrité et la lâcheté de la justice.
La circonstance peut, et doit, faire l’économie de ce « centre » autour duquel elle gravite, qui est l’œuvre. Si, Dans « la » circonstance, se croisent quasi nécessairement ce qui provient de l’entourage du sujet qui la perçoit et ce qu’il projette sur ces « faits contingents », elle ne peut plus se constituer que dans l’abstention. Si la temporalité des circonstances internes à cet observateur, donc celle de son énonciation, affecte la temporalité des faits et des circonstances extérieures par leur inéluctable incorporation, il y a tout intérêt à les protéger soigneusement, les unes comme les autres, de toute médiation. Il n’y a, effectivement, de pure extériorité dans le concept de circonstance que dans le cas où celui qui énonce une proposition circonstancielle se pose lui-même comme pure extériorité, ce qui ne peut que se résoudre, complètement, que dans l’autisme. L’abstention au monde trouve néanmoins des solutions partielles, mais conscientes, dans toutes les formes anti-dialectiques, anti-démonstratives de la « pensée sauvage », dans toutes les insurrections, dans toutes les rébellions qui sont, dans le domaine de l’action, les véritables « grèves » des hommes en révolte contre leurs tyrans.
Gérard Pelé est Professeur des Universités à l'ENS Louis Lumière et chercheur à l'ACTE, UMR 8218 (CNRS, Université Paris 1).